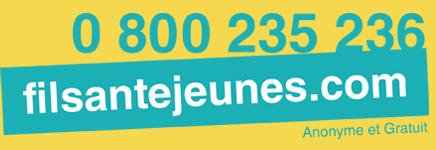Le risque : comment ça marche ?
Tout d'abord, il y a plusieurs types de prise de risque, qui vont de l'absence de contraception lors d'un rapport sexuel, à la conduite en excès de vitesse, ou sous l'emprise de l'alcool, en passant par les expérimentations de drogues plus ou moins ravageuses. Dans une société qui veut protéger à tout prix les siens, où le fait de fumer est devenu un comportement à risque, les individus se révoltent parfois en faisant tout le contraire de ce qui est recommandé, même si dans l'ensemble, nous savons que les discours préventifs sauvent des vies, par exemple sur la route.
Prendre des risques relève parfois, et même souvent d'une trop grande estime de soi, le fameux ça n'arrive qu'aux autres qui veut dire en un mot : moi, je suis plus fort. Ce sentiment est lié à une idée d'invulnérabilité, spécialement marquée chez les plus jeunes, qui n'ont pas l'expérience des blessures de la vie. Une phrase en tête, ça ne m'est jamais arrivé, ça ne m'arrivera jamais... . Mais pourtant, les jeunes n'ont pas besoin d'un accident grave en voiture avant de comprendre qu'elle est dangereuse et qu'il ne faut pas boire avant de prendre le volant.
Qu'est-ce qui fait alors que les chiffres nous montrent du doigt, en France comme de mauvais élèves de la mortalité des jeunes ? C'est une question trop complexe pour y répondre ici.
Diverses raisons poussent au non respect des limites, par exemple :
Le monde ne me satisfait pas, je souffre, je ne suis pas heureux(se), je me fous de tout, rien ne me retient... la catastrophe est alors imaginable.
Ainsi, un jeune de dix-huit ans vient d'avoir son permis. Il en est très fier et cela lui fait penser qu'il est enfin un adulte responsable. Ce jeune homme est quitté par sa petite amie et de colère, il prend sa voiture, et roule à une vitesse déraisonnable, emporté par le désespoir et par ses nerfs incontrôlables, parce qu'il a bu un verre d'alcool. Ce moment d'égarement lui fait perdre le contrôle de son véhicule...pour la suite, je vous laisse à vos journaux télévisés... aujourd'hui, deux voitures de jeunes se sont télescopées, bilan...
Pour résumer ce type de comportement, on pourrait dire ceci : le vie me fait du mal, alors je me fais du mal . C'est la même chose pour beaucoup de prises de risque, la prise de drogue, les rapports sans préservatifs etc. La révolte peut conduire à l'excès.
 « Casse-cou », « tête brûlée », « fonceur »… voilà quelques expressions pour parler de ceux qui prennent des risques, ou qui aiment en prendre. Pourtant, la notion de risque est souvent associée à la notion de danger. Pourquoi alors ce goût du risque chez certains ? D’où cela vient-il ?
« Casse-cou », « tête brûlée », « fonceur »… voilà quelques expressions pour parler de ceux qui prennent des risques, ou qui aiment en prendre. Pourtant, la notion de risque est souvent associée à la notion de danger. Pourquoi alors ce goût du risque chez certains ? D’où cela vient-il ?
C’est quoi un risque ?
Le risque est une notion complexe car elle mélange danger et plaisir. Dans le dictionnaire on lit que c’est « un danger plus ou moins prévisible ». Il n’y a aucune mention du plaisir. Pourtant, certaines personnes aiment prendre des risques intentionnellement, qu’ils soient mesurés ou pas. Définir un risque, c’est donc savoir trouver la délicate limite entre le risque « qui fait du bien » (qui permet par exemple de se surpasser et de réussir), de celui « qui fait du mal » (quand par exemple il est le reflet d’un profond mal-être).
Les mécanismes du risque
Prendre des risques, c’est avant tout dans le cerveau que ça se passe. C’est étroitement lié à la production d’hormones comme l’adrénaline et la dopamine. On va tenter de t’expliquer les choses le plus simplement possible. Dans le cerveau donc, prendre des risques c’est un peu comme vivre un grand stress : en cas de stress, le cerveau perçoit une agression et va produire en conséquence de l’adrénaline à haute dose. Cette adrénaline va entraîner une augmentation du rythme cardiaque, une accélération de la respiration, une oxygénation plus importante du cerveau et des muscles, une dilatation des pupilles, une surproduction de glucose. Ces phénomènes vont permettre de mobiliser l’organisme tout entier pour affronter le danger.
D’après plusieurs études il semblerait que le cerveau des ados encore en plein développement mesure différemment les risques.
Si tu veux être un expert du mécanisme biologique du risque, regarde cette petite vidéo très instructive et amusante !
Danger et plaisir
Dans une situation de risque le mécanisme est le même car il s’agit essentiellement de surmonter un danger. Mais, à la différence des situations de stress qui sont rarement volontaires, dans les situations de prises de risques volontaires, la production de dopamine (hormone du plaisir) est stimulée, ce qui procure un sentiment de satisfaction et de plaisir souvent intense ensuite. La production accrue de dopamine peut donner envie de recommencer pour ressentir à nouveaux ces émotions intenses.
Prendre des risques est pourtant nécessaire
Si on nous recommande sans arrêt de « faire attention », de ne pas y aller « car c’est dangereux »… oser prendre quelques risques est important pour pouvoir se débrouiller dans la vie. D’ailleurs, la vie elle-même n’est-elle pas un gros risque ? Risque de se faire mal, de tomber amoureux, de réussir, d’échouer, de mourir, de se surpasser, d’être triste, d’être heureux… ? De toute façon, quelqu’un qui ne voudrait prendre aucun risque ne pourrait plus sortir de chez lui !
Prendre des risques est un besoin. C’est une manière de préserver son équilibre physiologique et psychologique. Comme pour tout ce qui fait du bien mais qui devient dangereux si on en abuse : à consommer avec modération 😉 !