Le deuil aux quatre coins du monde
Comment se passent les rites funéraires, les gestes de réconfort à l'occasion du deuil, selon quelques cultures et croyances dans le monde ?
Dans la religion juive, l'âme quitte le corps pour aller dans un autre monde, au son des prières. Un proche ferme les yeux du défunt et un drap est posé sur son corps : par respect pour lui, plus personne ne le verra. Des veilleurs se succèdent ensuite pour réciter des psaumes jusqu'à l'enterrement. Celui-ci doit intervenir rapidement. La communauté escorte le corps du défunt au cimetière, et chacun jette sur le cercueil trois pelletés de terre. Ensuite, pendant 7 jours, la famille du défunt reste dans sa maison pour accomplir son deuil et recevoir les condoléances.
Chez les musulmans, la tradition veut que l'entourage soit très présent et hospitalier : les voisins préparent de la nourriture ; la famille, les amis, toute la communauté des croyants se pressent pour accompagner le défunt et sa famille. Le corps est lavé et préparé durant une toilette rituelle après laquelle il ne devra plus être touché pour ne pas être souillé : il peut ainsi partir à la rencontre de Dieu. Le défunt est ensuite recouvert d'un linceul blanc. L'enterrement doit avoir lieu rapidement après le décès (dans les 48h).
Chez les Chrétiens, la mort est un passage vers le repos de l'âme auprès de Dieu. Suite au décès, le corps est lavé, habillé, et placé dans le cercueil qui pourra rester ouvert pour que les proches voient le défunt une dernière fois. Un moment de recueillement ou de prières à la lumière de cierges accompagnent ces derniers moments avec la personne avant de sceller le cercueil. La couleur du deuil est le noir. Une cérémonie à l'église ou au temple précède l'inhumation. L'entourage témoigne de sa tristesse et de son soutien à la famille et aux proches.
Pour les hindous, la mort est un cycle et marque une continuité de la vie. Quand on meurt on passe dans un nouveau corps (humain, animal ou végétal) : c’est la réincarnation.
Les hindous pratiquent la crémation, c’est-à-dire que le corps du défunt est brûlé. Les cendres recueillies doivent être dispersées dans une rivière sacrée (le Gange si possible).
La couleur du deuil est le blanc. Lors des processions funéraires, le défunt est promené dans les rues de sa ville par ses proches sur une sorte de brancard entièrement décoré de fleurs. Les uns jouent de la musique pendant que d’autres chantent et dansent autour du défunt.
Les bouddhistes croient en l’impermanence de toute chose : la mort n’est qu’un épisode parmi d’autres dans le grand cycle des transformations. Il n’y a pas de séparation entre le corps et l’âme, donc pas de réincarnation possible mais une renaissance.
Les prières qui accompagnent le défunt lui permettent de se mettre dans un état d’esprit favorable à une renaissance. Il est en général incinéré plusieurs jours après sa mort. Les rites funéraires consistent en la toilette et la préparation du corps qui est ensuite emmené au monastère où les moines se relaient pour réciter des prières à son oreille. Le corps est entouré de bougies et de bâtons d'encens. Suite à la crémation, des offrandes et des cérémonies ont lieu pour faire l’éloge des mérites du défunt et favoriser une bonne renaissance.
Dans les croyances traditionnelles africaines, toute la communauté est présente pour que le mourant ne se sente pas abandonné. Les femmes le maternent, lui racontent des légendes. L'approche de la mort est aussi le moment de se confesser au mourant, de régler de vieilles querelles et de se réconcilier avec lui. La levée du deuil est une phase importante. Elle marque la fin de l'errance de l'âme, et son acceptation définitive dans la société des morts ou son accès au statut d'ancêtre. En Côte d'Ivoire, il a lieu environ un an après le décès, incorpore le défunt dans « le village des morts » et autorise la veuve à se remarier.
Certaines tribus comme les Guayaki du Paraguay ont d'autres rites funéraires : ils mangent les morts de leur groupe - avec lesquels ils ont presque toujours des liens de parenté -, pour maintenir l'unité et ne pas perdre ce que représentait le défunt. C'est une façon de s'approprier sa force et son savoir.
De même en Mélanésie, les Falateka, la consommation d'un membre d'une autre tribu représente la clôture du cycle funéraire, ce qui permet de renouer le dialogue avec les ancêtres.
La plupart des croyances ont en commun d'entourer le défunt et sa famille au moment du décès, de prononcer des paroles, d'accomplir des gestes pour apaiser, soulager la douleur de l'entourage et soutenir l'esprit du mort pour que le passage vers un ailleurs soit favorisé (vers le paradis pour les uns, aux village des ancêtres pour d'autres, etc...).
La communauté resserre ses liens pour montrer son respect et sa compassion aux endeuillés.
Les rituels associés au deuil sont l’occasion de dire au revoir, de rendre hommage au défunt en parlant de la vie qu'il a menée, de qui il était, de ce qu’il a apporté à la communauté, qui restera et sera transmis aux générations suivantes.
Tous ces témoignages d’affection et cette solidarité aident ceux qui restent à supporter la séparation, à se consoler, et à faire le deuil de la personne perdue.
 Que tu habites une cabane en Alaska, une yourte dans les steppes de Mongolie ou un appart’ à Lyon, chaque culture fait de la mort un moment particulier. Depuis toujours, le passage de la vie à la mort est mis en scène, on parle de rites funéraires. La façon dont les proches font leur deuil, peut être très différente en fonction de la culture de chacun.
Que tu habites une cabane en Alaska, une yourte dans les steppes de Mongolie ou un appart’ à Lyon, chaque culture fait de la mort un moment particulier. Depuis toujours, le passage de la vie à la mort est mis en scène, on parle de rites funéraires. La façon dont les proches font leur deuil, peut être très différente en fonction de la culture de chacun.
Faisons ensemble un tour de quelques traditions à travers l’histoire et le monde !
Dans l’histoire
Dans l’Egypte Ancienne, la mort ne signait pas la fin de la vie, mais le début de celle dans l’au-delà. Ils pensaient que l’Homme était constitué de plusieurs éléments qui vont lui garantir la vie éternelle. Mais pour cela, il faut que le corps soit préservé au mieux. C’est pour cette raison qu’ils momifiaient leurs morts. Selon un rituel précis, c’était la première étape pour parvenir à la renaissance et à la vie éternelle.
Dans la Grèce Antique, une pièce était déposée sur les yeux du défunt pour qu’il puisse payer le passeur qui lui permettrait de traverser le Styx, ce fleuve mythique qui sépare le monde des vivants de celui des morts. Lavé, parfumé et habillé des plus belles parures, il pouvait alors prendre la route du royaume des morts en toute sérénité.
Dans le monde
Dans les trois religions monothéistes (christianisme, judaïsme, islam), les défunts sont honorés et célébrés en famille. Le passage de la vie à la mort est un moment de partage qui accompagne le défunt vers un autre monde. Les différents textes religieux donnent à la fin de vie une place particulière. La vie ne s’arrête pas lorsque l’âme quitte le corps, quelque chose perdure dans l’au-delà.
Dans la tradition hindoue, l’âme du défunt abandonne le corps pour se réincarner ailleurs. L’incinération est très pratiquée car elle faciliterait la réincarnation. Enveloppé dans un drap mortuaire ou dans le traditionnel « sari », le corps est parsemé de fleurs, de senteurs et de « pindhs » (boules de farine et de riz) fabriquées par le prêtre de la communauté. Dans une coupelle, on fait brûler le « dia » (beurre non salé), pour nourrir l’âme du défunt. L’homme le plus proche, généralement le fils, se rase la tête et fait don de sa chevelure. Il fera cinq fois le tour du cercueil avec le « dia » et l’étalera sur sa bouche pour le nourrir de cette substance.
En Inde, le Gange est un fleuve sacré. Les cendres du défunt pourront être déposées sur une feuille de palmier sur laquelle un lampion sera accroché. Ce qui reste du corps sera emporté au gré des courants de ce fleuve millénaire.
Dans la tradition Navajo des Amérindiens, la mort est une étape qui se prépare tout au long de la vie. Pour les garçons, il existe un rite de passage dès l’enfance. À 6 ans, il doit se rendre dans la forêt pour capturer un animal. Dans un tronc, une gravure est sculptée pour le représenter. Ce rite sera renouvelé plusieurs fois au cours de sa vie et un totem sera constitué d’après ces sculptures. Lors du décès, le défunt sera honoré par ce totem, symbole de ses exploits. La population jeûne alors, ne se nourrit plus, pendant plusieurs jours pour se consacrer à la méditation et ainsi honorer la mémoire du défunt. Synonyme de renaissance, les Navajos considèrent la mort comme un évènement heureux, un moment de fête.
Aujourd’hui en France
Les rites et les traditions ont changé. Si la plupart de rites qui entourent la mort proviennent de la religion, cela ne veut pas dire pour autant que seuls les croyants donnent du sens à la mort. Chacun entretient un rapport singulier avec sa culture et peut la réinventer.
De nos jours, les funérailles peuvent avoir des contraintes, parfois administratives. Dans la tradition musulmane par exemple, l’enterrement doit avoir lieu très rapidement après le décès. Ce n’est pas toujours évident à mettre en place.
Peu importe la culture et l’époque, la mort occupe une place importante. Le décès d’un proche laisse à la famille un héritage de souvenirs et d’anecdotes qui vont le définir. La fin de vie est aussi le moment où l’on raconte l’histoire de celui qui nous quitte.
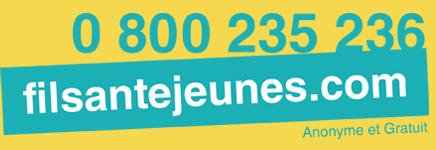



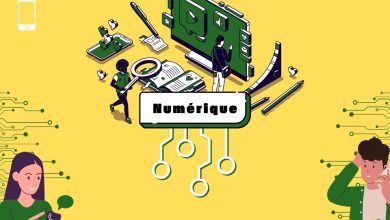












Bonjour, je souhaiterais aussi connaitre les sources quand aux rites funéraire grecs: pour moi la pièce (ou l’obole) se dépose dans la bouche, contrairement au film ****.
J’aimerai en apprendre d’avantage sur le sujet si je faisais erreur jusque là.
Merci.
Bonjour,
quelles sont vos sources concernant les rites funéraires Navajo?
Bonjour,
L’ensemble des articles sur ce site sont rédigés par des professionnels de la santé. Leurs sources sont multiples (internet, lecture, médias…) et il nous est difficile de retrouver la source précise de cet article qui date de 2007.
Bonne journée !
L’équipe Fil Santé Jeunes